|
| |
Retour page titre  Pages : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 Pages : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20

Dans la deuxième moitié du XVIIème siècle, on développa de
nouvelles techniques qui s'ajoutèrent aux traditionnelles méthodes de
dissection. L'une fut la découverte du microscope. L'histologiste MALPHIGI
examina le cortex qu'il considérait fait de ganglions. En 1699, on pensait
encore que le cortex produisaient les esprits animaux comme Willis et Sylvius le
soutenaient. Bien qu'ils se soient tous trompés, leurs conceptions
fonctionnelles survécurent pendant tout le XVIII ème siècle et
furent rejetées seulement quand on découvrit le neurone vers 1830.
Au milieu du siècle, un français, François Gigot de la Peyronie, découvrit
par hasard une corrélation qui devait faire date. Soignant un homme souffrant
d'une blessure profonde au crâne, il fut étonné de voir le patient
s'évanouir quand il lava la plaie. Lorsqu'il sécha la blessure, le blessé
reprit ses esprits. La Peyronie communiqua à ses pairs, en 1741, le résultat
de ses observations qui établissaient un fait de portée générale :
l'existence d'un rapport entre conscience et cerveau physique. L'idée plus
spécifique que certains processus mentaux résident dans des régions
distinctes du cerveau n'apparut que plusieurs décennies plus tard. Cette
théorie, appelée Localisation fonctionnelle "explosera" au début du
siècle suivant.
|
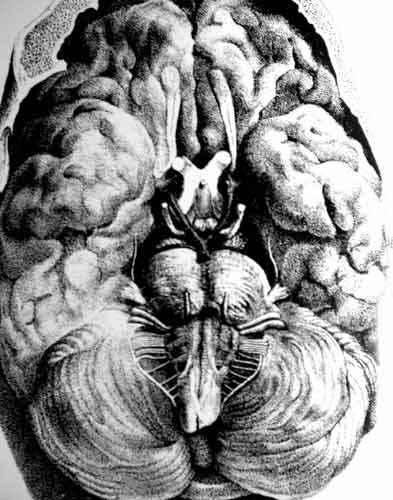
|
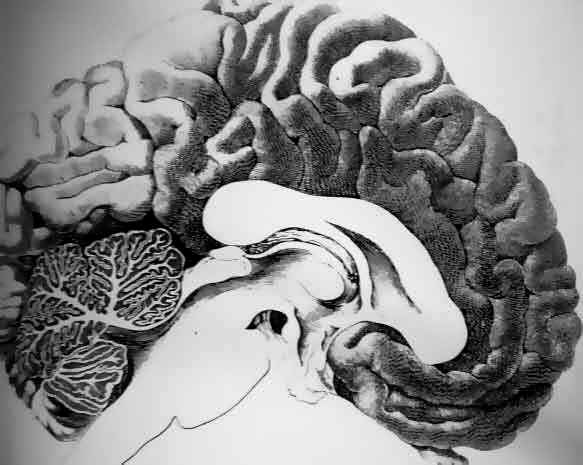
|
L'anatomiste italien Santorini publia en 1796
l'Anatomici. Ses schémas sont
précis, rigoureux. Les gyrus sont toutefois imparfaitement
représentés.
|
Les planches de Soemmering (1755-1830), anatomiste
Allemand, sont une contribution importante à l'art et à l'anatomie.
L'illustration ci-dessus semble être la première représentation
correcte de l'aspect des hémisphères cérébraux. |
|
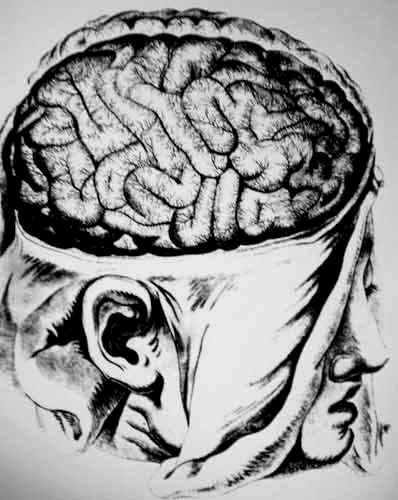
|
En 1781, le français Vicq d'Azyr publia un traité
d'anatomie dans lequel il s'appliqua à représenter les circonvolutions
cérébrales. En dépit de ses bonnes intentions, cette représentation
donne encore l'impression d'anses intestinales. Il commença cependant
de singulariser les gyrus en les groupant sous les termes antérieur,
postérieur et inférieur. C'est un progrès manifeste qui stimula
directement les recherches des anatomistes français préfigurant une
nouvelle ère pré-scientifique. |

|