 |
1450 : Ce dessin représente
l'oeil dans la tête humaine probablement prélevé dans un traité
d'ophtalmologie écrit par Maître Zacharias de Salerne et de
Constantinople au XIIème siècle. |

|
1490 :
Dessin d'Albert le Grand (1206-1280) publié en 1490.
Les fonctions vitales sont réparties dans les ventricules avec
l'introduction de "membo motiva" dans la troisième
cellule. Sur le cou est écrit : "les nerfs irradient à travers le
cou et les vertèbres dans tout le corps" |
 |
1490 :
Section sagittale de la tête réalisée par Léonard de Vinci. Cette
esquisse montre les trois cellules reliés entre elles. La 1 est en
connexion avec les yeux et les oreilles par des canaux représentant les
nerfs optiques et auditifs. |
 |
1501
:Johannes Versor illustre l'édition de "anima d'Aristote"
parue en 1501. Il existe 3 cellules, les 2 premières étant
subdivisées en deux. "Sensus communis" et "phantasia
dans la 1. "Imaginativa et Estimativa" dans la
2. "Memorativa" dans la 3. |
 |
1506
: Nouvelle édition de "philosophia pauperum"
parue en 1506. A noter les cellules divisées en 2 . Les fonctions sont
réparties dans les ventricules comme à l'ordinaire à cette période
de l'histoire. L'influence de Gallien (IIème siècle)
restant prépondérante. |
 |
1513 : Dessin
d'Aristote publié en
1513 à Hagenaw.
Les sens "spéciaux" sont nommés et les lettres correspondent
aux surfaces délimités avec précision
a : "sensus communis"
b : "phantasia" c : "cogitativa vel estimativa"
d:"imaginativa" e: "memorativa" |
 |
1525 :
Variante anglaise du dessin de Reisch apparue en 1525 dans un livre de
chirurgie de Hieronymus Brunschwig à Strasbourg. |
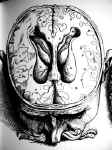 |
1543 :
Vésale est le plus grand anatomiste de la Renaissance et incarne la
transition avec le Moyen-âge. La qualité graphique et descriptive fait
un bond remarquable. Toutefois, les désignations médiévales des
ventricules sont maintenues. |
 |
1545 :
Voici la première vue de la base du cerveau. Relativement grossière,
elle ne ressemble pas à un dessin d'après nature. Les nerfs crâniens
sont classés d'après Galien. Les circonvolutions sont représentées
comme de l'intestin grêle. |
 |
1619 : Le
mystique alchimiste Robert Fludd publia ce dessin en 1619. Les cellules
cérébrales sont ébauchées et dans la première, l'oeil de l'imagination est sensé
représenter ce que les yeux transmettent. C'est
"l'oeil de l'esprit" |
 |
1641 : L'un
des livres d'anatomie les plus connus au XVIIème s.
fut celui de Johann Vesling, professeur d'anatomie à Padoue.
On y trouve la première représentation du cercle artériel de la base
du cerveau dix sept ans avant la description de Willis. |
 |
1672 :
Planche tirée du "De anima brutorum" de Willis
en 1672. Il mit un terme définitif à la théorie de localisation
ventriculaire héritée de l'antiquité. Par contre les circonvolutions
sont représentées "sans vie" et sans intérêt particulier. |
 |
1685 : Sténon
publia un gros ouvrage d'anatomie "Neurographia Universalis"
Il est à noter que les circonvolutions irréalistes et le cortex
ont suscité bien peu d'intérêt. Le tronc cérébral est représenté
grossièrement. |
 |
1790 : La
théorie de Gall (1758-1828) s'appelle la Phrénologie. Associé à Spurzheim
(1776-1832),
ils introduisirent un nouveau concept : la localisation corticale
associée à la théorie des bosses de la voûte. |
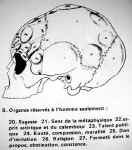 |
1819 : De
1810 à 1819, F.J. Gall publia sa fameuse théorie de localisation des
organes sur le crâne. Chacun d'eux est indiqué par une bosse. Si un
individu ne possédait pas une "qualité", une dépression
faisait place à la bosse. |
 |
1825 : La
phrénologie fut beaucoup d'émules dont l'anglais Georges
Combes qui publia en 1825 "System of Phrenology".
Il existe 33 organes dans le système Combes. |
 |
1825 : F.J
Gall fut toutefois un excellent anatomiste et réalisa des ouvrages
remarquables de précision. Néanmoins, il décrivit les gyrus comme des
"processus entériques" représentés effectivement comme de
l'intestin grêle. |
 |
1825 :
Autre schéma remarquable de Gall |
 |
1900 : Au
début du XXème siècle, la phrénologie avait gagné les Etats-unis et
ce schéma nous vient de l'américain J.W Redfield qui proposait
une variante : la Physiognomonie qui proposait pas moins de 160
localisations.
L'extravagance du concept allait définitivement enterrer la théorie. |
 |
1904 : Paul
Flechsig parvient à identifier 36 régions spécifiques du cerveau
par l'étude chronologique de la myélinisation. |
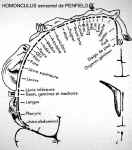 |
1957
: Le canadien Wilder Penfield, neurochirurgien (et son
collaborateur Rasmussen ), travailla pendant 30 années pour réaliser
une cartographie corticale exacte grâce aux stimulations électriques
directes du cortex chez des malades conscients. Quand un courant est
appliquée sur une zone corticale, il engendre une réponse qui sera
classée : sensorielle ou motrice. |
 |