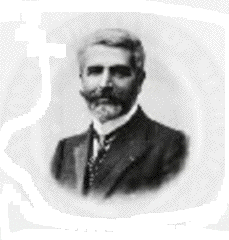"Ceux qui peinent beaucoup pour apprendre et pour comprendre et ceux qui, tristement et majestueusement, ne font rien, mais vitupèrent, ne pardonnent pas à qui travaille sans lamentation, à qui comprend et entreprend avec éclat..." MONDOR.
Paul POIRIER fut un travailleur enthousiaste, un anatomiste distingué, un chirurgien remarquablement doué, aimant se faire voir, être vu, connu et reconnu, personnage hors série qui retient l'attention.
Il naquit à Granville le 7 février 1853, de parents et de grands-parents normands. Élève au lycée d'Avranches il y fit des études satisfaisantes puis s'engagea à Rennes dans les mobiles où il voulut être clairon. Il y rencontra celui qui tout au long de sa vie fut son ami le plus sûr, le plus intime, le plus fidèle: Waldeck Rousseau dont on sait la carrière qu'il fit sous la IIIe République.
Ayant décidé de faire ses études de Médecine, il vint à Paris où il s'installa rue Monge, dans un appartement où sa mère venait le voir fréquemment. Il fut nommé externe en 1875, provisoire en 1876 chez Péan, interne en 1877 ; il fut toujours apprécié par ses différents maîtres qui le trouvaient "intelligent, instruit, d'esprit et de caractère aimables." Agrégé d'anatomie et de Physiologie en 1886; l'année suivante il fut nommé chef des travaux d'anatomie à la Faculté. Il avait exposé l'anatomie des lymphatiques des organes génitaux de la femme d'après les pièces injectées suivant la technique de Sappey. Farabeuf était alors professeur d'anatomie, jusqu'à la nomination de Poirier, les études étaient sérieuses et l'atmosphère sévère à la Faculté. Poirier la détendit aussitôt.
En novembre 1887, la première leçon du nouveau chef des
travaux que le "scandale P." venait de mettre fâcheusement
en vedette déchaîna les étudiants : un sadique assassin de trois femmes
avait été condamné à mort et exécuté, son corps fut, suivant l'usage,
envoyé à la Faculté où sa notoriété le désignait pour le laboratoire
du chef. Le journal "La Lanterne" accusa Poirier d'avoir
fait tanner la peau de P. et d'avoir offert deux portefeuilles au chef de la
Sûreté. Une enquête fut ordonnée par le ministère de l'Intérieur. Le
doyen indiqua que Poirier, au moment des faits, ne pouvait être incriminé
car il se reposait à Granville du concours auquel il venait d'être nommé.
L'œuvre anatomique réalisée à l'École Pratique par Poirier et son équipe
fut considérable:
- L'anatomie de l'articulation du genou, les insertions des muscles péri-articulaires,
des jumeaux en particulier, les bourses séreuses poplitées, les procès
synoviaux sus-condyliens, la synoviale et les téguments furent le sujet de
publications successives.
POIRIER démontra que, physiologiquement, les
ligaments croisés représentaient le véritable ligament postérieur;
- Les synoviales des fléchisseurs sont injectées et disséquées;
- La gaine préputiale décrite pour la première fois;
- La topographie cranio-encéphalique est précisée: points de repère
des scissures, trajet de la méningée moyenne, ventricules latéraux, sinus
frontaux...
- Mais encore : étude de l'oreille interne, de l'épididyme, de
l'uretère.
Il avait alors décidé de publier un "Traité d'Anatomie Topographique Médico-chirurgicale" dont le premier volume parut en 1892. Puis il se consacra d'urgence à la rédaction d'un "Traité d'Anatomie Descriptive." C'est Grégoire qui acheva la réalisation de ces publications entreprises par son maître Poirier.
Poirier avait été nommé chirurgien des Hôpitaux en 1889, puis en 1897, chef de Service à Ivry puis à Tenon. A l'hôpital il était un homme bon, aimé de ses malades. Les internes ne le quittaient guère et le suivaient aussi parfois le dimanche où, après une courte visite, Poirier"faisait du sport", de la bicyclette au bois avec culotte, bas, veston court et casquette ; ou du canot sur la Seine en tricot rayé et canotier de paille...
Les relations l'intéressaient beaucoup et il désirait les étendre.
C'est facile,
- lorsque l'on est l'ami intime de Waldeck-Rousseau et des Brunau-Varilla,
des Rothschild et du Prince de Monaco,
- que l'on chasse chez Ephrussi et Cahen d'Anvers,
- que l'on opère le fils de Lucien Guitry
- que l'on est appelé en consultation auprès de la Reine d'Italie et de la
Reine de Monténégro,
- que l'on adore sortir,
- et que l'on est intelligent, élégant et beau.
Son célibat qui choquait était attribué au souvenir toujours vif d'une
déception ancienne. Devant cet échec il décida de ne plus considérer les
femmes que comme une plaisante distraction. Il tint parole. Sa complaisance
à braver le conformisme, dépourvu de toute discrétion, son côté "carabin"
attardé, devenaient avec l'âge d'un goût souvent douteux... Les
chansonniers l'avaient surnommé : "le
premier gigolo de Paris."
On ne le ménageait guère mais on peut assurer qu'il était un opérateur
excellent. Quand un de ses collègues s'étonne qu'il ait opéré lui-même
une dame que l'on savait fort intime avec lui, Poirier répondit: "Si
je connaissais quelqu'un qui eût pu l'opérer mieux que moi, je la lui
aurais certainement confiée..."
Mais que peut-on penser de lui lorsqu'il préside une course de
bicyclettes des étudiants de première année et taquine avec eux les
demoiselles dans les guinguettes...
Contre la volonté du Conseil de la Faculté, le Ministre de l'instruction
publique le désigna en remplacement de Farabeuf à la chaire d'anatomie.
Le tumulte qui accompagna sa leçon inaugurale est resté célèbre. L'entrée
solennelle du doyen, de la délégation des professeurs et de Poirier fut
saluée de hurlements. Après l'allocution du Doyen, le chahut rythma une
chanson où étaient prêtés à "Popaul la Poire" les exploits du
célèbre abbé Dupanloup. Souriant et détendu, le professeur attendait.
Offusqués, Doyen et délégation se retirèrent. Poirier resta seul face à
l'amphithéâtre déchaîné. Devant l'évidente impossibilité de se faire
entendre, il écrivit lentement au tableau trois grandes majuscules : M,
puis E, puis R. Le tumulte augmenta encore. Il ajouta un C,
un I, salua et quitta la salle. C'est dans son amphithéâtre de l'École
Pratique rempli d'un auditoire devenu subitement silencieux qu'il lut, sans
en changer un mot, sa leçon inaugurale:
" Messieurs les Étudiants,
" Je cherche et retrouve mal les mots, cependant préparés, pour vous
remercier d'un accueil qu'à la vérité j'espérais aimable, et que votre
jeunesse me donne chaleureux à outrance..."
Certains accusèrent quelques professeurs d'avoir organisé le chahut,
d'autres restèrent convaincus qu'il l'avait mis au point lui-même.
Son cours était l'attraction de la Faculté. Son éloquence, l'apparat,
ses dialogues avec les étudiants, ses réparties désarmantes sont célèbres.
Il est accueilli par des cris un jour qu'il arrive en retard: "Messieurs,
le Capitole serait-il en danger!"
Ses activités accrues ne le faisaient pas négliger l'École d'Infirmières
qu'il avait créée avec Bourneville à Bicêtre. Il fut promu, en 1905,
officier de la Légion d'honneur.
La discussion sur le traitement de l'appendicite aiguë s'est poursuivie
pendant un an. Dieulafoy avait déclaré: "le
traitement médical de l'appendicite aiguë n'existe pas."
Poirier précise: "on doit intervenir systématiquement
aussitôt le diagnostic assuré ou même simplement soupçonné et l'on doit
toujours enlever l'appendice." Or, certains préconisaient encore
l'application de sangsues ; seule la collection d'un abcès semblait une
indication formelle à une intervention, cette temporisation avait failli récemment
être fatale au futur Edouard VII. La mortalité de l'appendicite aiguë était
encore de 18 p. 100 en moyenne à Paris.
Dans la discussion du traitement chirurgical des cancers, Terrier avait déclaré
: "La récidive est constante après les
interventions pour cancer. Les cas de guérison permanente sont pour moi des
erreurs de diagnostic." Mais Poirier insiste sur la nécessité
d'une intervention précoce et d'une exérèse étendue des voies de
propagation lymphatiques et ce, quel que soit l'organe atteint. Certains
s'inquiètent et pensent que cette technique peut conduire à de véritables
aberrations chirurgicales.
Mais Poirier répond "je ne puis comprendre qu'il
y aurait danger à préconiser des interventions bonnes dans certaines
mains, dangereuses dans d'autres... je ne connais qu'une catégorie de
chirurgiens, ceux qui sont dignes de ce nom en possédant les connaissances
indispensables à la pratique d'un art difficile et c'est à ceux-là que je
parle... "
Poirier fit de nombreuses communications et participa à d'innombrables discussions. Citons: la technique de gastrostomie, les fractures de jambes, les hydronéphroses, les résultats de ponction lombaire chez les traumatisés du crâne, le cathétérisme de l'uretère, qu'il fut le premier à réussir chez l'homme.
Il fut élu à l'Académie de Médecine en 1906 et y proposa à cette
occasion la création d'une ligue pour la lutte contre le cancer dont il précisa
le programme: éducation du public, instruction du médecin, fondation d'un
Institut d'études et de recherches. C'est la même année que "l'Association
Française pour l'Étude du Cancer" fut fondée par Poirier, Delbat
et Roussy, dont l'un des premiers souscripteurs fut Rothschild.
C'est la même année également que Poirier est remplacé à son cours par
Cuneo. Des crises douloureuses abdominales très violentes, de plus en plus
rapprochées, lui firent très rapidement porter, pour lui aussi, le
diagnostic de cancer du pancréas et il fit un jour très simplement, en fin
de matinée, ses adieux à ses collaborateurs en annonçant qu'il ne
reviendrait plus.
Il voulut revoir sa ville natale et sa mère mais, désirant lui épargner
le spectacle navrant de sa maladie, il revint à Paris où Cuneo le fit
hospitaliser à la Maison de Santé d'Auteuil où il mourut le 2 mai 1907.
A sa demande, le diagnostic fut vérifié et confirmé par l'autopsie.
Par testament, il légua à Granville la somme nécessaire à la
construction d'une maternité qui fut inaugurée le 15 juillet 1911 ainsi
que le buste du donateur.
"Ses dons éblouissants, ses succès trop ignorés, ont fait que si l'on s'est accordé sur ses prouesses on a trop contesté ses solides, ses sûrs mérites."
Le côté tapageur apparaît le premier, POIRIER l'a voulu ainsi et a soigneusement préparé une légende qui masque trop les qualités profondes: intelligence, travail, honnêteté, bonté...