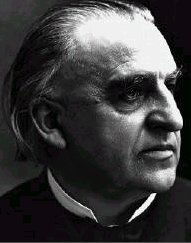Jean-Martin Charcot est né le 29 novembre 1825 à Paris, son père est carrossier, sa mère est une toute jeune femme de 16 ans et demi.
En 1826, Pinel disparaît, lui qui venait de jeté les bases de la psychiatrie scientifique, la relève sera assurée!
Charcot étudiant
Jean-Martin Charcot poursuit ses études secondaires au lycée
Bonaparte.
Vers 1844, il décide de devenir médecin. En 1848 il est interne des
Hôpitaux de Paris.
En 1853 Charcot est nommé chef de clinique à la Faculté de médecine.
Son maître, le Professeur Royer, le présente au banquier et futur
ministre Achille Fould qui l’ emmmène en Italie.
Médecin des Hôpitaux en 1856, il échoue au concours de l’agrégation
en 1857.
En 1860 il se présente pour la seconde fois à l’agrégation, il
doit sa nomination à son érudition et à Royer.
1862-1882: Charcot à la Salpétrière
En 1862 il épouse une riche veuve dont il aura deux enfants, Jeanne et Jean-Baptiste. Cette même année il est nommé Médecin-chef à la Salpétrière dans le quartier “Vieilles-femmes.” Cet immense réservoir de “chroniques” est alors un vaste hospice de 5.000 âmes que Charcot avait déjà connu en 1852 pendant son internat. C’est là que se décide son orientation scientifique.
De 1862 à 1870 son enseignement à la Salpétrière
est consacré aux maladies des vieillards.
Sa contribution à l'étude de la physiologie et de la pathologie du
système nerveux a été fondamentale, elle compte près de 700
publications. En véritable neurologue, Charcot décrivit les aspects
les plus typiques de certaines pathologies du système nerveux, comme:
• en 1861-1862, il présente une observation de “paralysie
agitante” connue sous le nom de maladie de Parkinson (1817).
• en 1863 il présente des travaux d’anatomie-pathologique sur la
goutte.
• en 1865 ce sont des travaux sur la paraplégie douloureuse des
cancers, sur l'anatomie et la physiologie du système nerveux, leçons
encore sur les maladies du poumon, du foie, avec la description du
lobule pulmonaire et du lobule hépatique, sur la pathologie des hémorragies
cérébrales,
• en 1868-1869 il s’intéresse à l’atrophie musculaire
progressive des mains, pouvant s’étendre aux bras, aux jambes, aux
muscles de la langue, du pharynx et du larynx. Pour l’étude de ces
cas il recevait l’aide précieuse de Guillaume Duchenne, qui , bien
que n’étant ni hospitalier ni universitaire, faisaient des
recherches sur les stimulations électriques des muscles.
Charcot pût décrire, avec son élève Joffroy, une maladie particulière
au cours de laquelle le malade avait une sclérose des cordons latéraux
de la moelle épinière (faisceaux moteurs) s'accompagnant, du fait
des atteintes des cellules motrices de la corne antérieure, de l'
amyotrophie citée plus haut. Il donna à cette maladie le nom de sclérose
latérale amyotrophique, dite aussi, depuis, Maladie de Charcot.
• La même année il fut le premier à donner une symptomatologie
complète de la sclérose en plaques qu’il différencie d’avec la
maladie de Parkinson.
En 1867 naît son fils Jean-Baptiste Charcot. On a parfois reproché
à Jean-Martin Charcot d’avoir orienté son fils Jean-Baptiste vers
la médecine alors que sa vocation était la Mer. Celui-ci deviendra néanmoins
organisateur d’expéditions océanographiques, et disparaîtra en
1936 à bord du “Pourquoi pas?”
En 1870, pendant le siège, Charcot interrompt ses travaux pour se
consacrer aux malades atteints de la variole et de la typhoïde.
En 1872 il est nommé à la Chaire d’ anatomo-pathologie de la
Faculté.
Aussi c’est avec la méthode qu’il appela anatomo-pathologique (études
des symptômes lors de la maladie, puis des lésions à l’autopsie),
qu’il poursuivit des travaux sur les localisations cérébrales: il
put ainsi affirmer, concept nouveau à l’époque, que le cerveau,
loin d’être homogène, était une association de territoires divers
ayant des fonctions distinctes.
Il continue à la Salpétrière ses leçons de clinique neurologique.
Ses qualités de conférencier lui valent d’être élu, en 1873, Membre de l’Académie de Médecine et Membre de l’Académie des Sciences en 1883.
1882-1893: Essor de l’École de la Salpétrière
En 1882 la faculté de Médecine de Paris crée pour Charcot une chaire de Clinique des maladies du système nerveux dans laquelle il accomplira une oeuvre immense, qui allait devenir la plus grande clinique neurologique d’Europe. Il sera en effet chef d’École et ses élèves s’appelleront A. Pierret, Joffroy, Paul Richier, Raymond, Brissaud, Gilbert Ballet, Pierre Marie, Bourneville, Bouchard, Gilles de la Tourette et Joseph Babinski, en sommes tous les grands neurologues et psychiatres français et étrangers. Le plus célèbre de ses étudiants, en 1885, fut Sigmund Freud, qui observe pendant quatre mois, à l'hôpital de la Salpétrière, les manifestations de l'hystérie, les effets de l'hypnotisme et la suggestion et tombe sous le charme du maître qu'il décrit en ces termes à sa fiancée : "Charcot, un des plus grands médecins et dont la raison confine au génie, est en train de démolir mes conceptions et mes desseins. La graine produira-t-elle son fruit, je l'ignore ; mais que personne n'a jamais eu autant d'influence sur moi, de cela je suis sûr." Il propose à Charcot de traduire certains de ses ouvrages en allemand : "Leçons sur les maladies du système nerveux" est publié en 1886.

Les leçons du mardi à la Salpétrière, qu’il fait devant les plus grandes personnalités parisiennes de la science, des arts et de la politique, et Léon Daudet décrit son hospitalité “fastueuse” ainsi que devant les neurologues du monde entier, resteront à jamais célèbres, ce sont des événements scientifiques et mondains.
La neurologie fut pour Charcot un des fondements de son activité de psychiatre. C’est dans ce domaine, et plus particulièrement dans celui de l’hystérie, et de l’hypnotisme, que Charcot s’attira tout un public non médical séduit par ce genre de phénomènes alors à la mode. C’est dans ses descriptions magistrales de l’hystérie que Charcot assit l’autorité de l’école de la Salpétrière. C’est dans ses méthodes d’hypnose qu’il la rendit critiquable.
La pédagogie de Charcot s'appuie sur la méthode
anatomo-clinique qu’il a largement perfectionnée, ainsi que
l'utilisation de techniques plus modernes, comme la pathographie ( équivalent
écrit des manifestations corporelles).
Charcot se sachant mauvais orateur, prépare longuement ses cours. il
complète l'élaboration de son diagnostic, basé sur l'observation
lente, minutieuse des malades, par la prise de clichés à tous les
stades de l'observation, par des esquisses d'un mouvement, d'une déformation
frappante, d'une contracture. Ces croquis se retrouvent dans les
manuscrits de ses leçons qui sont agrémentées de tableaux
synoptiques, de courbes, de la mise en évidence par Charcot lui-même
des gestes caractéristiques de la maladie.
Parmi ses collaborateurs il choisit des personnalités
appartenant aux disciplines philosophiques et se justifie en écrivant:
“Jusqu'à présent, on s'est habitué à
mettre la psychologie à part, on l'enseigne au collège, mais c'est
une psychologie à l'eau de rose qui ne peut servir beaucoup. C'est
une autre psychologie qu' il faut créer, une psychologie renforcée
par les études pathologiques auxquelles nous nous livrons”
Charcot est devenu un consultant national et international. Sa réputation
de savant et de médecin est exceptionnelle.
L’Hystérie et l’hypnose
Sous son influence, la maladie mentale commença à être systématiquement
analysée; et l'hystérie, à l'étude de laquelle Charcot se consacra
depuis 1870, fut distinguée des autres affections de l'esprit. Il met
au point la description de la “grande hystérie”
et complète cette description par le recours à l'hypnose, comme
moyen de reproduire expérimentalement la crise hystérique.
Les techniques d'induction hypnotiques rappellent les moyens utilisés
par les magnétiseurs.
Entre Mesmer et Freud: on peut voir dans l’hypnotisme la forme la
plus évoluée du magnétisme mesmérien. Dans les mains de Charcot,
c’est un moyen d’ étude en vue de découvrir une base organique
à l’hystérie.
Charcot décrit trois phases successives à ce qu’il a appelé le
grand hypnotisme ou la grande névrose hypnotique:
• la léthargie, obtenue par compression des globes oculaires
par exemple, elle se caractérise par par l’occlusion des paupières,
l’ hypotonie des muscles et une vivacité des réflexes ostéo-tendineux.
• la catalepsie, s’obtient par l’ ouverture des paupières
du sujet, elle se caractérise par immobilité du sujet avec une
hypertonie musculaire, abolition des réflexes ostéo-tendineux, une
disparition de la volonté psychique et physique. Le sujet garde les
yeux ouverts.
• et le somnambulisme provoqué. Il est caractérisé par une
hyperesthésie, une anesthésie à la douleur contraste avec une
audition accrue, une très grande sensibilité aux odeurs et une
hypermnésie. Les hallucinations visuelles sont intenses et précises.
Il montra que les sujets étaient suggestio nables, qu’on pouvait
leur faire accomplir des actes plus ou moins raisonnables:
Utilisant l'hypnose comme moyen de traitement, Charcot induisait chez
ses patientes une attaque hystérique qui répondait à ses normes.
L'ennui, c'est que les patientes, comme ses collaborateurs, étaient
plus enclins à confirmer les vues du maître qu'à mener une véritable
recherche scientifique.
Mais Charcot entreprit aussi d’étudier l’influence des métaux et
des aimants sur les phénomènes hystériques: ce furent la métalloscopie
et la métallothérapie.
Les plus grandes critiques de ces méthodes vinrent de l’école
de Nancy. Hippolyte Bernheim objecta à Charcot le caractère
artificiel de son hypnotisme: “tous les phénomènes
constatés à la Salpétrière…n’existent pas alors que l’on
fait les expériences dans des conditions telles que la suggestion ne
soit pas en jeu, les sujets ne les réalisent que lorsqu’ils savent
qu’ils doivent les réaliser.”
Il est indéniable que Charcot n’a pas fait preuve dans ce domaine
de son objectivité et de sa prudence habituelles. Il est aussi
probable que ses assistants aient leur part de responsabilité dans
ces expériences spectaculaires et publiques. Brillants cliniciens,
ils pensaient être observateurs, alors qu’ils ils étaient, au
moins en partie, inducteurs des phénomènes hypnotiques.
Par ailleurs, Babinski , un de ses fidèles élèves, reconnaît que
Charcot "eut le tort de faire ses
cliniques sur la grande hystérie et sur l'hypnotisme non seulement
pour des médecins mais aussi pour un public non médical; ses leçons
attiraient les gens du monde, des acteurs, des littéraires, des
magistrats, des journalistes, des hommes politiques et quelques médecins.
La présentation des sujets en état de léthargie, de catalepsie, de
somnambulisme, de sujets présentant des crises violentes,
ressemblaient trop à de la mise en scène théâtrale".
Quoiqu’il en soit, Charcot, qui était sur le point de réviser entièrement
ses conceptions au moment de sa mort, a apporté sa contribution dans
un domaine encore mal connu. Freud qui fut son élève allait faire
repartir la science dans une nouvelle direction.
En 1888 éclate le scandale de Panama qui allait durer dix ans. En
1893 le banquier parisien Cornélius Herz se réfugie en Angleterre;
il est arrêté à Bournemouth. Le gouvernement français ayant demandé
son extradition, l’inculpé se prétendit malade. deux experts dont
Charcot furent nommés pour en décider; après examen, ils conclurent
à l’état grave de Herz et l’estimèrent intransportable.
Ces conclusions qui ne répondaient pas au désir de l’opinion
publique leurs valurent les attaques de la presse qui les accusa
d’ignorance, de partialité et même de corruption.
C’est trois ans plus tard que Herz fut condamné à cinq ans de
prison pour chantage envers la Compagnie de Panama.
Froid, réservé, silencieux, Charcot était cependant doué d’un charme singulier. Sa notoriété, son autoritarisme, son allure distante devait fatalement lui attirer des inimitiés.
Le 16 août 1893, Jean-Martin Charcot meurt d’un œdème aigu du poumon au cours d’un voyage près du lac des Settons dans la Nièvre. A ses obsèques nationales, aux nécrologies dithyrambiques succède l'oubli de son oeuvre.
Durant vingt ans de 1873 à 1893, Charcot sera véritablement l’âme de la médecine moderne, formant d’ innombrables élèves auxquels il inculqua non seulement le goût de la méthode anatomo-clinique, mais aussi le goût de la médecine générale sans laquelle il ne saurait y avoir de bon médecin.